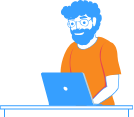Quel rôle l'agriculture joue-t-elle dans la transition énergétique ?
La France s’est engagée pour la neutralité carbone d’ici à 2050 via la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Objectif : diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) de moitié entre 1990 et 2030. Grâce à sa capacité à capter du carbone et à produire de l’énergie renouvelable, l’agriculture a un rôle important à jouer dans la transition énergétique.
Conformément aux engagements de l’Accord de paris, la France doit atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Pour décarboner l’économie, il est bien sûr nécessaire de diminuer significativement les gaz à effet de serre (GES). L’agriculture doit notamment réduire ses émissions de 46 %.
Par ailleurs, la France doit continuer de développer les énergies renouvelables pour remplacer progressivement la dépendance aux énergies fossiles. Or, le rôle de l’agriculture s’avère essentiel pour réussir cette transition énergétique.
Qu’est-ce que la transition énergétique ?
La transition énergétique est un concept désignant la réduction des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Elle recouvre également les actions liées à l’efficacité énergétique. L’objectif est de décarboner l’économie.
La transition énergétique est considérée comme un volet de la transition écologique, qui touche plus globalement à la préservation des écosystèmes et ressources naturelles.
Transition énergétique : vers une nouvelle feuille de route
La France s’est dotée d’une feuille de route énergétique : la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). L’actuelle, datant de 2020, fixe des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2028, notamment pour le photovoltaïque, dont la capacité installée devrait atteindre entre 35,1 et 44 GW.
Cependant, une nouvelle version de la PPE, plus ambitieuse, est en cours d’élaboration pour mieux aligner la planification énergétique avec les engagements climatiques de la France. Dans cette future mouture, le gouvernement envisage notamment de porter la capacité photovoltaïque nationale entre 75 et 100 GW à l’horizon 2035, ce qui nécessiterait une accélération significative du déploiement, de l’ordre de 5,5 à 7 GW par an.
Qu’est-ce que la neutralité carbone ?
La neutralité carbone se traduit par un équilibre entre les émissions et l’absorption de carbone dans l’atmosphère. Pour atteindre la neutralité carbone, il faudrait que les émissions mondiales de GES soient compensées par la captation du carbone. Le sol, les prairies, les forêts ou les océans, sont considérés comme des puits de carbone : ils captent davantage de carbone qu’ils n’en émettent.
Aujourd’hui, nous émettons beaucoup plus de carbone que nous n’en séquestrons. Les puits de carbone naturels captent entre 9,5 et 11 gigatonnes de CO2 par an. Or, d’après une étude du Global Carbon Project, les émissions mondiales annuelles de CO2 ont atteint 37,4 Gt en 2024, voire 41,6 Gt en prenant en compte les émissions liées au changement d’affectation des terres (ex : déforestation).
L’agriculture productrice d’énergie renouvelable
Pour atteindre ses objectifs de neutralité carbone, la France s’appuie sur le développement de l’économie du vivant : c’est la bioéconomie. Il s’agit d’utiliser des ressources renouvelables pour produire de l’énergie et des matériaux plus respectueux de l’environnement et moins émetteurs de GES.
Pour contribuer à cette transition énergétique, la France encourage les agriculteurs à devenir producteurs d’énergie.
Méthanisation : produire du biogaz ou de l’électricité
Les unités de méthanisation agricole, ou « à la ferme », valorisent les effluents et déchets organiques en produisant du biogaz.
Les projets de méthanisation portés par les entreprises comme ENGIE BiOZ reposent sur des partenariats avec des agriculteurs locaux. Ces derniers approvisionnent la centrale de méthanisation en matières agricoles (effluents, résidus de paille…) et reçoivent en retour du digestat solide et/ou liquide pour fertiliser leurs cultures.
En 2022, la France comptait près de 900 unités de méthanisation à la ferme (Méthafrance). Plus des deux-tiers produit de l’électricité et de la chaleur (cogénération). La chaleur cogénérée permet de chauffer un bâtiment d’élevage ou sécher des fourrages, par exemple. Les autres unités de méthanisation produisent essentiellement du biométhane qu’elles injectent dans le réseau de gaz naturel.
Les déchets agricoles et les déchets agro-alimentaires représentent le potentiel de production de 90 % du biogaz envisagé en 2050 (Ademe).
L’énergie solaire photovoltaïque
De nombreux agriculteurs installent des panneaux photovoltaïques sur les hangars ou bâtiments d’élevage. Ils vendent et/ou auto-consomment l’électricité produite, ce qui leur assure une rémunération ou une économie substantielle à long terme. Aujourd’hui, le secteur agricole contribue à 6 % de la production photovoltaïque en France (Insee).
L’agrivoltaïsme pour allier production agricole et électricité verte
L’agrivoltaïsme combine production agricole et production d’énergie solaire. Les panneaux photovoltaïques, fixes ou mobiles, sont installés sur les parcelles agricoles (cultures ou prairies) et tiennent compte des besoins des agriculteurs. Les engins agricoles doivent en effet pouvoir passer entre les structures. Depuis 2023, la loi APER (accélération de la production d’énergies renouvelables) et ses décrets encadrent la définition de l’agrivoltaïsme. Pour éviter toute dérive, l’agrivoltaïsme doit obligatoirement contribuer à maintenir, développer ou améliorer durablement la production agricole.
L’énergie solaire thermique
Les panneaux solaires thermiques permettent de chauffer l’eau ou les bâtiments. Intéressant surtout en élevage, pour économiser de l’énergie !
Le bois énergie
La biomasse provient de cultures dédiées (miscanthus, switchgrass…) ou de l’entretien des haies bocagères et bois. Le bois est utilisé par les agriculteurs pour chauffer les bâtiments d’élevage, sécher des fourrages, chauffer une serre agricole… Il peut également être vendu, notamment sous forme de plaquettes ou granulés.
L’éolienne à la ferme
Selon l’Ademe, les éoliennes d’une puissance inférieure ou égale à 36 kW sont considérées comme du petit éolien. Un tel projet peut être envisagé sur une parcelle bien exposée au vent : au moins 15 km/h pour commencer à produire de l’électricité, et plus de 40 km/h pour produire à pleine puissance. La variabilité du gisement de vent et le nombre d’heures de fonctionnement à pleine puissance sont les principales limites de ce système. L’électricité produite peut être autoconsommée, vendue, ou les deux à la fois.
La géothermie
La géothermie utilise la chaleur du sous-sol pour chauffer, par exemple, des serres agricoles ou des bâtiments d’élevage. C’est une source d’énergie encore peu utilisée dans le milieu agricole.
D’autres leviers agricoles pour décarboner la France
Outre la production d’énergies renouvelables, l’agriculture a un rôle à jouer pour capter du carbone et réduire ses émissions de GES. Pour atteindre la neutralité carbone, la France encourage donc les pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement comme l’agriculture biologique ou l’agro-écologie.
Les émissions de gaz à effet de serre en agriculture
L’agriculture est le 2ème poste d’émission de GES de la France, avec 19 % des émissions nationales (86 Mt CO₂eq/an).
Ses émissions sont composées :
à 44 % de CH4, qui provient notamment de l’élevage (fermentation entérique et déjections animales),
à 42 % de N2O, venant des cultures (épandages de fertilisants minéraux et organiques)
à 14 % de CO2, résultant des consommations d’énergie fossile (engins agricoles, bâtiments de l’exploitation…)
Le rôle de l’agriculture dans la captation de carbone
L’agro-écologie vise à allier la productivité agricole aux pratiques plus vertueuses pour l’environnement. Ces pratiques favorisent la captation du carbone par le sol et les plantes : les prairies permanentes, l’agroforesterie, le non labour, le semis direct, la plantation de légumineuses... Elles favorisent la matière organique dans les sols, augmentent la capacité de stockage de carbone et contribuent à compenser les émissions de gaz à effet de serre.
L’agriculture de précision pour une agriculture plus durable
L’énergie utilisée en agriculture ne se résume pas qu’à l’électricité, au gaz ou au carburant des tracteurs. Pour être produits, les engrais de synthèse consomment de l’énergie : on parle d’énergie indirecte. L’agriculture conventionnelle peut en réduire l’utilisation, notamment grâce à l’agriculture de précision. Cette démarche consiste à produire mieux avec moins de ressources, pour tendre vers une agriculture durable.
En agriculture de précision, les pratiques agricoles sont adaptées aux besoins des cultures au sein d’une même parcelle. En effet, de nombreux paramètres peuvent varier à l’échelle intra-parcellaire : stress des cultures, topographique, propriétés du sol… Les besoins en intrants sont donc différents en fonctions des zones. Par exemple, en fertilisation, l’objectif est d’apporter la bonne dose au bon endroit et au bon moment, avec un zonage le plus fin possible.
L’agriculture de précision nécessite l’analyse de données (topographique, humidité, propriétés physico-chimiques du sol…) collectées par des capteurs, satellites ou drones connectés à des applications mobiles ou web.
En adaptant ses pratiques et en valorisant son potentiel énergétique, l’agriculture peut devenir un moteur de la neutralité carbone, conciliant production alimentaire et durabilité.

Votre bilan personnalisé en économies d'énergie
Gratuit, sans engagement
Personnalisez vos équipements et usages
Réalisez votre bilan d'économies d’énergie